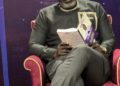« Véritable mastodonte de la procédure pénale », le procureur de la République ne cesse de constater ces dernières années l’accroissement de son activité judiciaire et juridictionnelle. La communication du ministère public sur l’événementiel voire les points de presse prévus par la loi 2016-30 du 08 décembre 2016 illustre, à biens des égards, l’augmentation du nombre de missions qui lui sont attribuées.
En effet, « à l’heure des chaines d’informations en continu et des réseaux sociaux », le procureur de la République ne peut plus, en application de l’article 11 CPP, refuser de communiquer sur un grave fait divers,-attentat terroriste, crime sexuel- ou encore sur des actes de détournement de deniers publics présumés ou révélés.
La communication du procureur avec les médias sur les affaires pénales est devenue une exigence contemporaine. Il s’agit d’une nouvelle mission liée, en quelque sorte, à l’air du temps. Cette attribution récente met, en évidence, le caractère obsolète des dispositions du code de procédure pénale interdisant les conférences de presse du procureur de la République. Elle prouve à suffisance que la communication « est devenue un impératif pour le magistrat du parquet. Elle est au carrefour des attentes publiques »: l’on se garde encore en tête, les accusations de détournement de derniers publics du Président Ousmane SONKO à l’égard de Mamour DIALLO ou encore les révélations du député Moustapha Cissé LO sur la gestion des semences…
Ces différentes révélations ou dénonciations n’ont pas pourtant poussé le procureur à ouvrir une enquête encore moins de tenir un point de presse pour informer l’opinion publique sur la politique pénale à mener en tant que mandataire de la Cité. Cette attitude du magistrat fait que certains se demandent finalement si le procureur de la République exerce véritablement une « fonction judiciaire républicaine ».
A cet égard, le parquet peut-il refuser d’éclairer l’opinion publique sur sa politique criminelle surtout lorsque les faits sont de nature à entraver la bonne marche des politiques publiques de l’Etat ? Peut-il continuer à garder le silence en adoptant la stratégie selon laquelle « si la parole est d’argent, le silence vaut de l’or ». Sa communication avec médias ou le droit à l’information du public est-il un devoir ou une obligation ?
En tout état de cause, nous admettons qu’à l’heure actuelle, la communication du procureur est une obligation ardente. C’est un impératif des temps modernes (I). Elle rencontre cependant quelques limites liées au respect des principes cardinaux notamment le droit à l’innocence présumée, le respect du secret de l’enquête et de l’instruction ou encore les exigences de la défense nationale…
I. La communication du procureur avec les médias; une exigence de la modernité.
Le procureur de la République doit, à sa qualité de représentant de la nation souveraine, se donner pour mission d’informer objectivement le public sur les faits événementiels voire sur les procédures en cours ou pendante devant la justice. Le public revendique la sortie de son mandataire car il veut comprendre le dénouement de certaines affaires.
Le procureur de la République est devenu à cet égard « un communicant judiciaire en phase avec la modernité ». Sa communication est très attendue : les caméras et les micros sont tous tournés vers lui, ses paroles font la une des quotidiens d’information car c’est de lui que dépend la suite des affaires. L’orientation du dossier de la procédure dépend de la perception qu’il a des faits. Il ne peut plus, à ce titre, refuser de communiquer avec les médias sur les faits d’actualité. Le citoyen l’exige puisqu’il veut comprendre la suite réservée aux faits faisant d’une révélation sur la place publique. La justice pénale incarnée par le parquet doit donc communiquer voire révéler ce qu’elle connait. Le procureur a un devoir voire une obligation de communiquer sur sa politique répressive. Les exigences du moment font que le procureur ne peut plus garder le silence en faisant prévaloir l’idée selon laquelle « ne pas communiquer, c’est communiquer ».
La communication du procureur est, d’ailleurs, analysée pour reprendre l’expression du procureur général Jacques DALLEST comme « un facteur d’apaisement et d’information sur le travail de la justice ». La justice pénale incarnée par le procureur doit donc s’exprimer car une meilleure communication par le parquet participe, sans nul doute, à la promotion de son indépendance. « L’agir communicationnel » est donc un aspect fondamental. Il permet d’éviter en application de l’article 11 CPP, la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou du moins d’assurer la protection de l’ordre public
Cependant comment communiquer ? La communication judiciaire n’a-t- elle pas ses réalités ? Quels sont les mots que le parquetier doit employer ?
En effet, avec l’évolution technologique des médias, l’instantanéité et la concurrence des réseaux sociaux, on a l’impression d’assister à une presse avide d’informations. La presse veut connaitre et divulguer toutes les informations relatives aux faits. Cette perception est contraire aux exigences de la justice. Car, pour la justice le temps compte peu. Et le parquet est astreint au respect de certaines exigences dans le cadre de sa communication. Communiquer est certes une exigence pour le parquet mais elle peut être aussi une souffrance car s’exprimer « devant un parterre de journalistes, de cameramen et de preneurs de sons est un exercice redoutable » surtout lorsqu’on n’est pas formé à cet exercice.
« L’éthique communicationnelle » est indispensable au procureur de la République. C’est dire que le parquet doit, dans le cadre sa communication ou de ses conférences de presse, respecter un certain nombre de principes cardinaux.
II. Les contraintes de la communication parquetière.
La communication est un art difficile pour le procureur de la République. Les difficultés de sa communication émanent du fait qu’il doit rechercher à concilier, dans le cadre de ses points de presse, des impératifs contradictoires. Il en est ainsi du droit à l’information du public mais aussi du respect des principes cardinaux notamment la présomption d’innocence ou le secret de l’enquête et de l’instruction.
Le procureur de la République doit, dans le cadre de sa communication, respecter le principe du secret de l’enquête et de l’instruction conformément aux dispositions de l’article 11 CPP. En clair, le magistrat du ministère public ne peut pas tout dire au cours de ses conférences de presse. Cela est compréhensible car « la presse a ses raisons qui ne sont pas celles de la justice » et que « la justice a ses impératifs que les médias oublient ». Dans cette perspective, il ya lieu de noter que les impératifs de la justice ou du droit à l’information confèrent au procureur de rendre public des éléments objectifs du dossier de la procédure mais ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre le suspect. Cette démarche implique une pédagogie communicationnelle mais aussi un esprit d’ouverture à l’égard du parquet. Son discours doit être réfléchi et bien préparé pour éviter qu’on lui reproche d’avoir étalé sur la place publique des informations qu’il n’aurait pas dû relater. L’éthique communicationnelle du procureur est donc une exigence d’une bonne administration de la justice. On se rappelle d’ailleurs de la communication du procureur de Thiès sur l’affaire du feu Sérigne CHEIKH Béthio THIOUNE concernant le double meurtre de Médinatou Salam. Les avocats du guide religieux étaient sortis pour dénoncer le point de presse du procureur. Ils estimaient que le procureur avait déjà violé le secret de l’enquête et la présomption d’innocence en présentant leur client comme étant « l’instigateur de ces agissements criminels ».
Néanmoins, le respect du secret de l’enquête et de l’instruction n’est pas la seule problématique de la communication parquetière. La communication du procureur rencontre d’autres contraintes. Il en est ainsi notamment du respect de l’ordre public, des exigences de la défense nationale ou encore du droit à l’innocence présumée.
Le respect de la présomption d’innocence ou du droit à un procès équitable prévu par les instruments juridiques internationaux, est une autre contrainte pour le parquet. Le droit à l’innocence présumée est une limite au droit à l’information du public. Le procureur doit, d’une part, tenir des points de presse afin « d’éviter la propagation d’information parcellaires ou inexactes » et, d’autre part, il doit, au cours de ses conférences, respecter les principes cardinaux de la justice pénale. En clair, le parquetier doit, au cours de ses points de presse, prendre en compte la présomption d’innocence voire les droits de la défense de la personne suspectée ou poursuivie.
Babacar NIASS, Doctorant en droit Privé/ UCAD.
Chercheur à l’Institut des sciences criminelles de Poitiers. ISC-EPRED